Introduction : Le constat en quelques chiffres clés
L’égalité entre les femmes et les hommes est un pilier fondamental de toute société juste, mais le chemin vers sa pleine réalisation est encore semé d’embûches. Malgré des décennies de lutte et des avancées significatives, les inégalités persistent dans toutes les sphères de nos vies. Des bancs de l’école aux dirigeants, en passant par les salaires et la sphère privée, les chiffres sont là pour le rappeler : seuls 10 % des Chef·fe·s d’État dans le monde sont des femmes, l’écart salarial mondial atteint 20 %, et dans le secteur numérique en France, la part des femmes peine à dépasser les 17 %.
Le contexte historique : Un combat de longue date
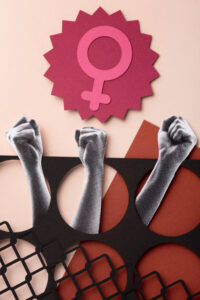 L’aspiration à l’égalité n’est pas nouvelle, elle est le fruit d’un long et courageux combat qui a traversé les siècles et les continents.
L’aspiration à l’égalité n’est pas nouvelle, elle est le fruit d’un long et courageux combat qui a traversé les siècles et les continents.
Le mouvement prend ses racines dès 1848 aux États-Unis, avec la première convention pour les droits des femmes sous l’impulsion d’Elizabeth Cady Stanton et de Lucretia Mott, qui revendiquent des droits civils, sociaux, politiques et religieux. Cette étincelle se propage, et dès 1893, la Nouvelle-Zélande devient le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes, marquant une étape historique.
Au fil du XXe siècle, les luttes se multiplient et s’intensifient. La révolte des femmes d’Aba au Nigéria en 1929 voit des milliers de femmes s’unir contre l’injustice, forçant des chefs à démissionner et supprimant des taxes discriminatoires. Plus tard, en 1960, les « Las Mariposas » (les sœurs Mirabal) en République Dominicaine deviennent des figures emblématiques de la résistance féministe, leur assassinat le 25 novembre déclenchant un mouvement d’indignation qui mènera au renversement de la dictature et à la désignation de cette date comme Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Les institutions internationales prennent également le relais avec la naissance des Nations Unies en 1945, dont la charte consacre l’égalité hommes-femmes, et la création d’ONU Femmes en 2010. Les années 1990 sont jalonnées d’avancées majeures avec la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) et le Programme d’action de Beijing (1995), qui définissent 12 domaines essentiels pour l’avancement des droits des femmes. Le XXIe siècle voit de nouvelles vagues de mobilisation, notamment les soulèvements de femmes dans les États arabes dès 2011, où elles revendiquent l’inscription de l’égalité dans les constitutions, ou encore le puissant discours de Malala Yousafzai aux Nations Unies en 2013, icône de la lutte pour l’éducation des filles.
L’arsenal législatif : Des lois et des failles persistantes
Face à ces réalités, un cadre juridique solide s’est progressivement mis en place à tous les niveaux.
Au niveau international, l’égalité est un ODD (Objectif de Développement Durable) : Adopté par les Nations Unies en 2015, l’ODD n°5 vise à « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Il est connecté aux 16 autres objectifs et définit des cibles claires : lutte contre les discriminations et les violences, accès des femmes aux fonctions de direction, et accès universel aux droits sexuels et reproductifs. Cependant, l’ONU estime qu’au rythme actuel, il faudra 300 ans pour mettre fin au mariage des enfants et 140 ans pour une représentation égale des femmes aux postes de pouvoir.
La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), adoptée par l’ONU en 1979 et ratifiée par plus de 180 pays, est un traité international contraignant qui engage les États signataires à promouvoir l’épanouissement des femmes dans tous les domaines.
Au niveau européen, la notion d’égalité de traitement : Une directive européenne de 1976 a posé les bases de l’égalité de traitement, invitant les États membres à supprimer les discriminations envers les femmes. L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), créé en 2010, œuvre également à promouvoir ces principes.
En France, une législation progressive mais imparfaite : L’article 3 du Préambule de la Constitution de 1946 affirme que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». De nombreuses lois sont venues concrétiser ce principe :
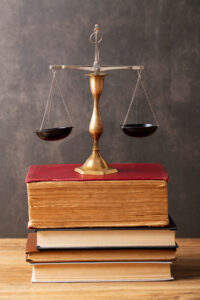
- Loi du 22 décembre 1972 : Affirmation de l’égalité de rémunération pour un travail égal.
- Loi Roudy du 13 juillet 1983 : Transposition de la directive européenne, elle réaffirme l’égalité dans toute la vie professionnelle (recrutement, rémunération, promotion) et instaure l’obligation pour les entreprises de produire un Rapport Annuel sur la Situation Comparée des femmes et des hommes (RSC).
- Loi Génisson du 9 mai 2001 : Crée une obligation de négociation sur l’égalité professionnelle en entreprise.
- Loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011 : Fixe des quotas de femmes dans les conseils d’administration (20% après 3 ans, 40% après 6 ans). Une loi du 15 octobre 2024 vient renforcer ce dispositif.
- Loi du 04 août 2014 pour l’égalité réelle : Réforme le congé parental, sanctionne davantage les licenciements discriminatoires.
- Loi du 05 septembre 2018 (Liberté de choisir son avenir professionnel) : Rend l’égalité salariale une obligation de résultats et instaure l’Index de l’égalité femmes-hommes (note sur 100). En 2024, la note moyenne des entreprises est de 88/100, mais les écarts persistent.
- Loi Rixain du 24 décembre 2021 : Impose des quotas de postes de direction dans les grandes entreprises (40% de femmes cadres dirigeantes d’ici 2030).
Ces textes sont accompagnés par l’action de nombreuses structures comme ONU Femmes au niveau mondial, l’EIGE en Europe, ou encore la Fondation des Femmes et les CIDFF en France, qui œuvrent au quotidien pour l’autonomisation et la protection des droits des femmes.
Les freins et les préjugés : Quand l’invisible devient visible
Malgré cet impressionnant arsenal législatif et la mobilisation des organisations, des freins puissants persistent, souvent ancrés dans les mentalités et les stéréotypes.
En 2020, une étude de l’ONU révélait un chiffre sidérant : 9 personnes sur 10 dans le monde (hommes et femmes confondus) nourrissaient au moins un préjugé sexiste. Ce constat alarmant, pour lequel aucun progrès n’a été fait en 10 ans selon le PNUD en 2023, révèle la profondeur des inégalités de perception. Plus terrifiant encore, 28 % des gens dans le monde pensent qu’il est normal qu’un homme batte sa femme.
Ces préjugés se manifestent au quotidien sous forme de sexisme ordinaire, souvent minimisé mais omniprésent. Dans la publicité, par exemple, ⅔ des personnages sexualisés sont des femmes, et 98% des publicités pour des produits d’entretien ciblent uniquement les femmes. Ces représentations stéréotypées renforcent les rôles de genre et les inégalités.
Face à ces réalités, les mouvements sociaux jouent un rôle crucial en donnant une voix aux victimes et en dénonçant l’inacceptable. Des hashtags comme #EverydaySexism (créé en 2012 pour recueillir les témoignages de sexisme ordinaire), #NiUnaMenos (mouvement latino-américain contre les violences faites aux femmes, né en 2015), et bien sûr #MeToo (lancé en 2017 suite à l’affaire Weinstein, avec ses déclinaisons comme #BalanceTonPorc en France), ont permis de briser le silence et de forcer une prise de conscience mondiale. Le mouvement HeForShe, initié par ONU Femmes et Emma Watson, vise également à engager les hommes dans ce combat.
Des exemples concrets : L’Islande et le Japon, deux réalités contrastées
La diversité des situations montre l’ampleur du défi et la nécessité d’une vigilance constante.
 L’Islande, un modèle imparfait mais résolument engagé : Souvent citée comme le pays le plus égalitaire au monde, l’Islande a une histoire riche de luttes féministes. Dès 1882, les Islandaises obtiennent le droit de vote local. En 1975, plus de 90 % des femmes islandaises descendent dans la rue, stoppant le pays pour dénoncer les inégalités salariales. Cette « journée libre des femmes » est réitérée chaque année. En 1980, l’Islande est le premier pays au monde à élire une femme présidente, et plus récemment, elle a rendu obligatoire l’égalité salariale dans les entreprises de plus de 25 salariés. Pourtant, même là, la lutte continue : en 2023, les femmes islandaises ont à nouveau fait grève sous le slogan « Et vous appelez ça égalité ? », car elles gagnent encore en moyenne 9% de moins que les hommes.
L’Islande, un modèle imparfait mais résolument engagé : Souvent citée comme le pays le plus égalitaire au monde, l’Islande a une histoire riche de luttes féministes. Dès 1882, les Islandaises obtiennent le droit de vote local. En 1975, plus de 90 % des femmes islandaises descendent dans la rue, stoppant le pays pour dénoncer les inégalités salariales. Cette « journée libre des femmes » est réitérée chaque année. En 1980, l’Islande est le premier pays au monde à élire une femme présidente, et plus récemment, elle a rendu obligatoire l’égalité salariale dans les entreprises de plus de 25 salariés. Pourtant, même là, la lutte continue : en 2023, les femmes islandaises ont à nouveau fait grève sous le slogan « Et vous appelez ça égalité ? », car elles gagnent encore en moyenne 9% de moins que les hommes.
Le Japon, un modèle à développer : À l’autre extrémité du spectre, le Japon se classe seulement 118e au Forum économique mondial en 2024 en matière d’égalité. Discrimination, harcèlement sexuel, et injonctions vestimentaires sexistes (le mouvement #Kutoo contre l’obligation de porter des talons hauts) sont le quotidien de nombreuses Japonaises. Le mouvement #MeToo n’y a pas eu le même impact qu’ailleurs, et les femmes n’occupent qu’environ 10 % des postes à responsabilités. Malgré un léger progrès (5 femmes ministres sur 19 en 2023), le pays a encore un chemin considérable à parcourir.
Conclusion : Une lutte de tous les jours, pour toutes et tous
De ces chiffres, de ces récits historiques et de ces comparaisons internationales émerge une vérité indéniable : l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas un acquis, mais un processus dynamique qui exige une vigilance et un engagement constants. Des quotas aux index, des mouvements sociaux aux réformes législatives, chaque avancée est le fruit d’une large mobilisation.
Chez Arondor, nous nous inscrivons dans cette démarche, comme en témoigne notre index égalité femmes-hommes de 85/100 en 2024. Nous sommes convaincus que l’égalité femme / homme est une source de réussite collective, un moteur de progrès social et économique. Il s’agit d’un défi global et intergénérationnel pour construire un avenir juste et prospère, il est essentiel de déconstruire les préjugés, de soutenir les droits des femmes et des filles, et d’œuvrer, chaque jour, à bâtir un monde où l’égalité ne sera plus un objectif à atteindre, mais une réalité vécue par toutes et tous.



Commentaires récents